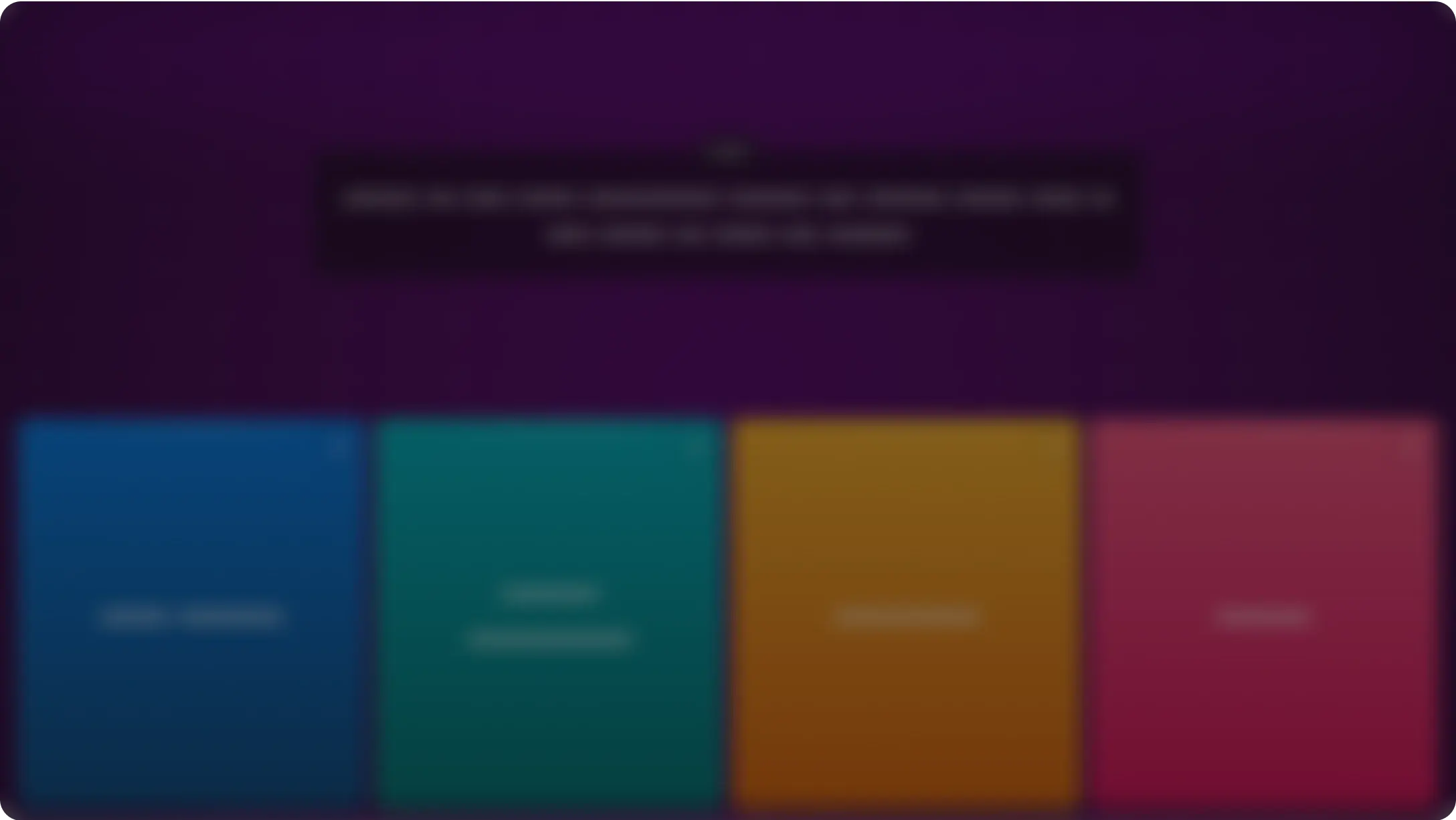PHILOSOPHIE MORALE, 1
Quiz
•
Philosophy
•
KG
•
Medium
Emmanuel PEHAU
Used 5+ times
FREE Resource
5 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE SELECT QUESTION
5 mins • 1 pt
« L’expérience m’avait appris que toutes les occurrences les plus fréquentes de la vie ordinaire sont vaines et futiles ; je voyais qu’aucune des choses qui étaient pour moi cause ou objet de crainte ne contient rien en soi de bon ni de mauvais, si ce n’est à proportion du mouvement qu’elle excite dans l’âme : je résolus enfin de chercher s’il existait quelque objet qui fût un bien véritable, capable de se communiquer, et par quoi l’âme, renonçant à tout autre, pût être affectée uniquement, un bien dont la découverte et la possession eussent pour fruit une éternité de joie continue et souveraine. »
C'est par cette déclaration que Baruch Spinoza ouvre son Traité de la réforme de l'entendement, écrit vers 1661 mais publié seulement de façon posthume, en 1677.
Les qualités par lesquelles il définit l'objet qu'il dit s'être « enfin » résolu à chercher renvoient à un concept des plus classiques en philosophie pratique.
On l'appelle traditionnellement :
L'amour.
L'anneau unique. (« mon précieux »)
Le saint Graal.
Le souverain bien. (summum bonum en latin)
2.
MULTIPLE SELECT QUESTION
10 mins • 1 pt
« S’il est à tous nos actes un but définitif que nous voulions atteindre pour lui -même et en vue duquel nous recherchions tout le reste ; si, d’un autre côté, nous ne pouvons pas dans nos déterminations remonter sans cesse à un nouveau motif, ce qui serait se perdre dans l’infini et rendrait tous nos désirs parfaitement stériles et vains, il est clair que le but commun de tous nos vœux sera le bien, et le bien suprême. Ne faut-il point penser aussi que, pour la règle de la vie humaine, la connaissance de cette fin dernière ne soit d’une haute importance ? et que, comme des archers qui visent à un but bien marqué, nous soyons alors mieux en état de remplir notre devoir ? » (Aristote, Éthique à Nicomaque, ch. I, §§6-7)
« Le mot qui le désigne est accepté à peu près par tout le monde ; le vulgaire, comme les gens éclairés, appelle ce bien suprême le bonheur ; et dans leur opinion commune, vivre bien, agir bien est synonyme d’être heureux. Mais c’est sur la nature et l’essence du bonheur que les opinions se partagent ; et sur ce point, le vulgaire est très-loin d’être d’accord avec les sages. Les uns le placent dans des choses apparentes et qui éclatent aux yeux, comme le plaisir, la richesse, les honneurs, tandis que d’autres le placent ailleurs. » (Aristote, Éthique à Nicomaque, ch. II, §§ 2-4)
Pourquoi est-il essentiel, pour Aristote, que tout le monde, en parlant de bonheur, reconnaisse l'existence d'un mobile suprême et secondaire que l'on puisse se disputer sur le contenu concret de ce mobile suprême ?
Parce qu'Aristote est philosophe et qu'un philosophe ça préfère l'abstrait au concret.
Parce qu'Aristote pense que l'idée de "fin naturelle" est à rejeter : c'est une contradiction dans les termes. Si nous cherchons à fonnder nos jugements moraux, à trouver une justification ultime pour nos choix de vie, nous ne pouvons que régresser à l'infini. Nous n'avons pas à chercher une "règle de la vie humaine" et donc nous n'avons pas à nous angoisser.
Parce que si on admet un mobile suprême dont découle tous les désirs possibles, on admet en même temps qu'il y a un but universel et donc naturel au-dessus la multiplicité des désirs, on admet donc implicitement qu'il y a une réponse nécessaire et naturelle à la question de savoir en quoi exactement ce but consiste, une réponse naturelle et nécessaire à la question de "la règle de la vie humaine".
Parce qu'Aristote est philosophe et qu'un philosophe, ça n'aime pas les disputes.
3.
MULTIPLE SELECT QUESTION
10 mins • 1 pt
« La nature a placé l’humanité sous le gouvernement de deux maîtres souverains, la douleur et le plaisir. Il n'appartient qu'à eux de déterminer ce qu'il nous est nécessaire de faire aussi bien que ce que nous nous obligerons à faire. » (Jeremy Bentham, Une introduction aux principes de la morale et de la législation, 1789)
« La déontologie ne demande pas de sacrifice définitif . Elle propose à l'homme un surplus de jouissances. Il cherche le plaisir, elle l'encourage dans cette recherche ; elle la reconnaît pour sage, honorable et vertueuse ; mais elle le conjure de ne point se tromper dans ses calculs. (...) Elle demande si, pour la jouissance goûtée aujourd'hui, il ne faudra pas payer un intérêt usuraire. (...) La tâche du moraliste éclairé est de démontrer qu'un acte immoral est un faux calcul de l'intérêt personnel et que l'homme vicieux fait une estimation erronée des plaisirs et des peines. » (Bentham, Déontologie, 1834, posthume)
« Avec le bénéfice d’une certaine expérience, on peut affirmer la proposition générale suivante : chacun est meilleur juge qu’autrui ne peut jamais l’être de ce qui conduit à son bien-être. » (ibid.)
« En saine morale, le devoir d'un homme ne saurait jamais consister à faire ce qu'il est de son intérêt de ne pas faire ; par une juste estimation il percevra la coïncidence de ses intérêts et de ses devoirs. » (ibid.)
Ces déclarations renvoient à un même principe, le seul à même, selon Bentham, de ramener à un fondement solide tous nos jugements moraux.
On l'appelle traditionnellement :
Le principe d'intransitivité.
Le principe d'utilité.
Le principe d'analyse.
Le principe de l'intérêt bien compris.
4.
MULTIPLE SELECT QUESTION
10 mins • 1 pt
Laquelle de ces formules n'est PAS une manière d'exprimer l'impératif catégorique auquel est suspendu la validité de tous nos jugements et de tous nos choix moraux selon Kant:
Fais ce que voudras.
Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en LOI UNIVERSELLE DE LA NATURE.
Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans celle de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen.
Tout être raisonnable doit agir comme s’il était toujours par ses maximes un membre législateur dans le règne universel des fins.
5.
MULTIPLE SELECT QUESTION
2 mins • 1 pt
Au niveau moral, l'autonomie se définit en opposition avec l'hétéronomie et aussi avec :
L'homonymie.
L'hystérectomie.
L'anomie.
La licence.
Similar Resources on Wayground

10 questions
romain gary qcm
Quiz
•
12th Grade

10 questions
L'art
Quiz
•
KG - Professional Dev...

10 questions
Louis Aragon "La guerre et ce qui s'ensuivit"
Quiz
•
10th Grade - University

10 questions
les leçons de Tristan et Iseut
Quiz
•
10th Grade - University

10 questions
De quoi est-on responsable?
Quiz
•
12th Grade - University

10 questions
Les conceptions de la vérité
Quiz
•
1st - 12th Grade

10 questions
Voltaire
Quiz
•
9th - 12th Grade

10 questions
Le temps et L'existence
Quiz
•
12th Grade
Popular Resources on Wayground

15 questions
Hersheys' Travels Quiz (AM)
Quiz
•
6th - 8th Grade

20 questions
PBIS-HGMS
Quiz
•
6th - 8th Grade

30 questions
Lufkin Road Middle School Student Handbook & Policies Assessment
Quiz
•
7th Grade

20 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
3rd Grade

17 questions
MIXED Factoring Review
Quiz
•
KG - University

10 questions
Laws of Exponents
Quiz
•
9th Grade

10 questions
Characterization
Quiz
•
3rd - 7th Grade

10 questions
Multiply Fractions
Quiz
•
6th Grade