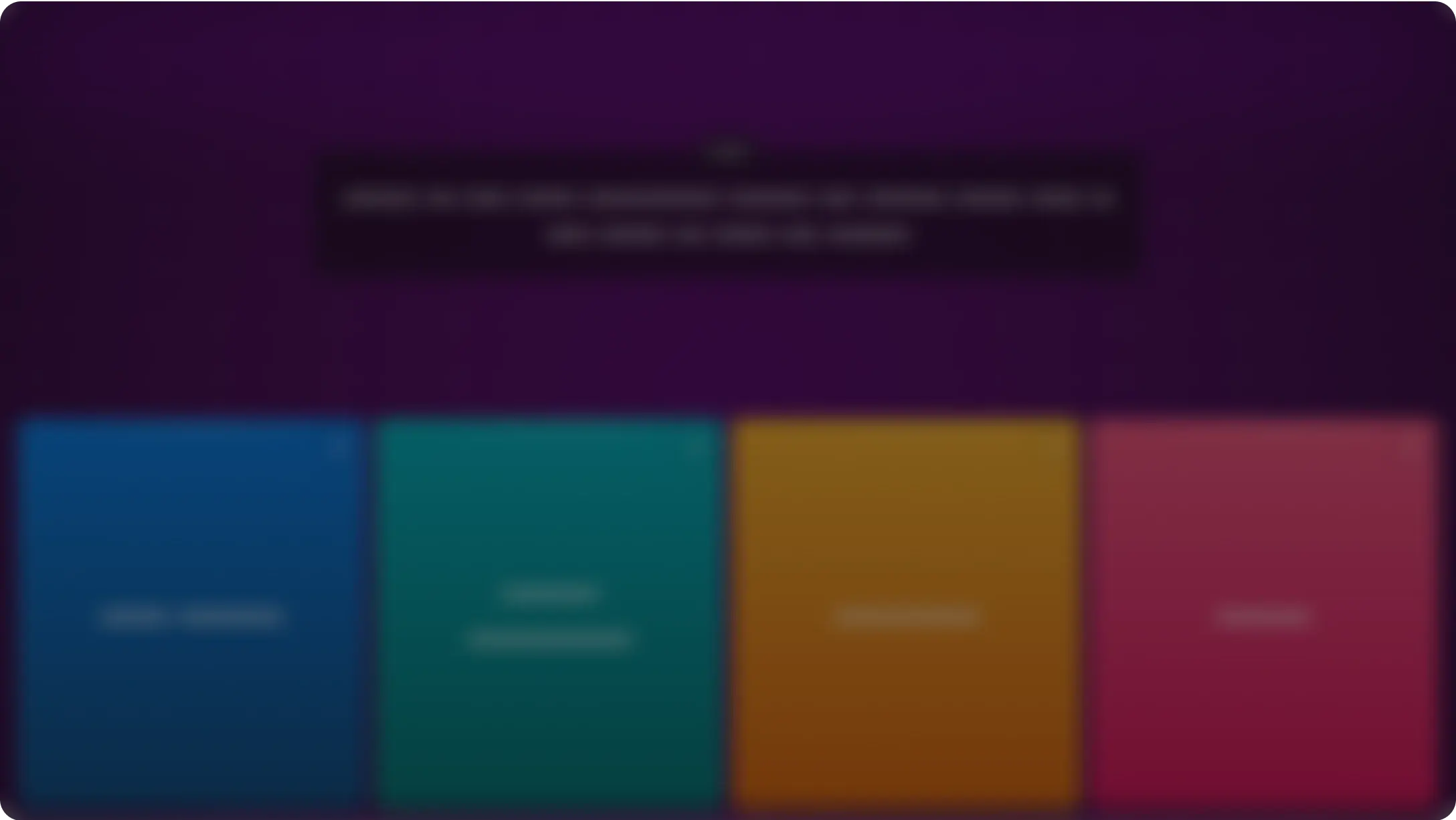PHILOSOPHIE MORALE (VERSION LONGUE)
Quiz
•
Philosophy
•
2nd Grade
•
Practice Problem
•
Medium
Emmanuel PEHAU
Used 10+ times
FREE Resource
Enhance your content in a minute
15 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
En philosophie, on désigne le concept de la liberté par le terme d'autonomie (= la capacité à se donner des règles par soi-même), définie en opposition avec le terme d'hétéronomie (= la nécessité où on se trouve d'adopter des règles venues de l'extérieur). Mais la liberté ne s'oppose pas seulement au fait d'être exclu de la source des règles que l'on a à suivre et de ne pas pouvoir se diriger soi-même, elle s'oppose aussi au fait d'être privé totalement de direction, de ne pas pouvoir (ou de ne pas savoir) s'appuyer sur des règles d'où qu'elles viennent.
Sur le plan moral, cet autre état opposé à l'état de liberté s'appelle :
Homonymie.
Anomie.
Hystérectomie.
Licence.
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Pour parvenir à la liberté comme expression de l'autonomie personnelle, il faut donc que notre conduite soit ferme, cohérente, intègre ; qu'elle ne change pas du tout au tout au gré des circonstances, au gré des revirements de notre environnement naturel ou social. Savoir comment y parvenir revient donc à comprendre comment l'individu peut se doter de force de caractère. (Ou, en termes plus littéraires : comment il peut s'armer de vertu.)
Ce pourquoi, en philosophie, l'étude des sources et des formes rationnelles de la moralité s'appelle :
L'éthique.
La diététique.
La déontologie.
La censure.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 1 pt
Pour faciliter l'exercice de la vertu, il faut pouvoir nous appuyer sur des règles qui possèdent un caractère de certitude, qui possèdent une forme de nécessité (naturelle ou structurelle), afin que nous puissions nous appuyer sur elles avec assurance, peut-être même avec entrain. Des règles aussi, qui possèdent un caractère de simplicité (par opposition à la sophistication des "codes" sociaux ou légaux) afin que nous puissions les trouver ou les retrouver par nous-même et ne pas dépendre du jugement d'autrui.
Une règle de cette sorte s'appelle :
Loi.
Principe.
Norme.
Concept.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
CHERCHEZ L'INTRUS.
Parmi les termes conceptuels suivants, lequel ne désigne pas une famille de "règles premières".
Impératif catégorique.
Valeur existentielle.
Usage traditionnel.
Critère naturel.
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 1 pt
À côté des règles qui "s'imposent d'elles-mêmes" à notre esprit parce qu'elles expriment sa propre force, il y a celles que nous laissons s'imposer "comme d'elles-mêmes" parce que la vie de l'esprit semble se confondre avec leur efficacité (règles de la culture, transmise par l'éducation, les échanges...), les règles de la moralité effective (qui est ce que le langage courant appelle "les moeurs" ou, de façon plus brutale, "la morale"). Et face à ces deux ordres de règles, il y a les règles qui ne peuvent manquer de paraître à la fois hétéronomes et arbitraires, tant leur contenu est obscur, mystérieux à force de sophistication, voire d'ésotérisme - quand elles ne revendiquent pas franchement un caractère mystique et une source transcendante.
Une règle de ce type s'appelle :
Requisit.
Canon.
Chicane.
Arcane.
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 mins • 1 pt
CHERCHEZ L'INTRUS.
En philosophie, on peut donc rejeter comme contraires à l'éthique certains comportements qui peuvent se trouver considérés comme moraux d'un point de vue profane ou "désarmé", mais qui ne peuvent coïncider avec la moralité que par accident, soit que le sujet y dissimule son incapacité à savoir "se tenir" par lui-même en l'absence de sanction (manque de vertu, attitude licencieuse), soit qu'il s'y montre trop capable de "se tenir" sans même chercher à savoir "à quoi il tient" (manque de principes, hétéronomie relative), soit parce que la "règle de vie" qu'il y applique, à laquelle il se tient, lui sert justement à ne plus vivre, ne plus "être là", lui permet de faire comme s'il n'en allait plus de lui-même dans ses choix (hétéronomie radicale, abolition de soi).
Sachant cela, laquelle des appellations ci-dessous ne sert pas à désigner une attitude philosophiquement immorale ?
Le relativisme moral (ou la "morale provisoire").
L'opportunisme.
Le conformisme (ou la "morale d'emprunt").
Le fanatisme moral .
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
CHERCHEZ L'INTRUS.
Parmi toutes ces oppositions, laquelle ne relève pas de la moralité rationnelle ni même de la moralité effective, mais de l'approche mystique de la moralité ?
Le mesuré et le violent.
Le bien et le mal.
Le singulier et l'indifférent.
Le normal et le pathologique.
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google
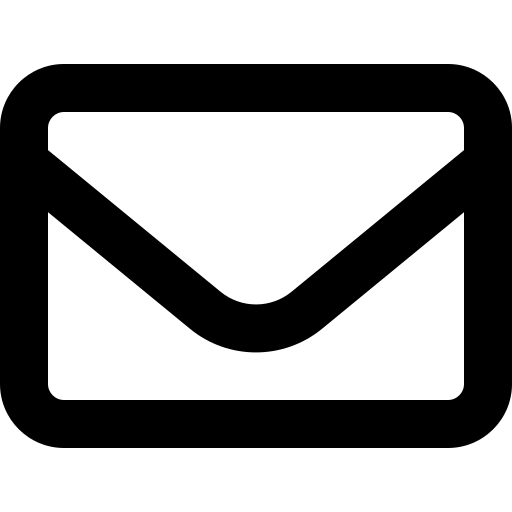
Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?
Similar Resources on Wayground

10 questions
PRUEBA DIAGNOSTICA CAMPO HISTÒRICO 5º
Quiz
•
1st - 5th Grade

10 questions
Ética segundo parcial
Quiz
•
1st - 10th Grade

15 questions
Ética tercer parcial
Quiz
•
1st - 10th Grade

10 questions
Introducción a la Bíblia
Quiz
•
1st - 4th Grade

12 questions
Avaliação 2 Ano
Quiz
•
2nd Grade

10 questions
Questionário sobre o Mito da Caverna
Quiz
•
2nd Grade

20 questions
9º ANO AVALIAÇÃO PROCESSUAL - 2º TRIMESTRE
Quiz
•
1st - 10th Grade

11 questions
Quiz sobre Hobbes e o Estado
Quiz
•
1st Grade - University
Popular Resources on Wayground

8 questions
2 Step Word Problems
Quiz
•
KG - University

20 questions
Comparing Fractions
Quiz
•
4th Grade

15 questions
Fractions on a Number Line
Quiz
•
3rd Grade

20 questions
Equivalent Fractions
Quiz
•
3rd Grade

25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade

10 questions
Latin Bases claus(clois,clos, clud, clus) and ped
Quiz
•
6th - 8th Grade

22 questions
fractions
Quiz
•
3rd Grade

7 questions
The Story of Books
Quiz
•
6th - 8th Grade
Discover more resources for Philosophy

8 questions
2 Step Word Problems
Quiz
•
KG - University

10 questions
Martin Luther King, Jr. For Kids
Interactive video
•
1st - 12th Grade

10 questions
Dr. Martin Luther King Jr.
Quiz
•
2nd Grade

20 questions
Counting Coins
Quiz
•
2nd Grade

20 questions
Place Value
Quiz
•
KG - 3rd Grade

12 questions
Telling Time to the Hour and Half Hour
Quiz
•
1st - 3rd Grade

19 questions
Subject-Verb Agreement
Quiz
•
2nd - 5th Grade

17 questions
Inches, Feet and Yards Review
Quiz
•
2nd Grade